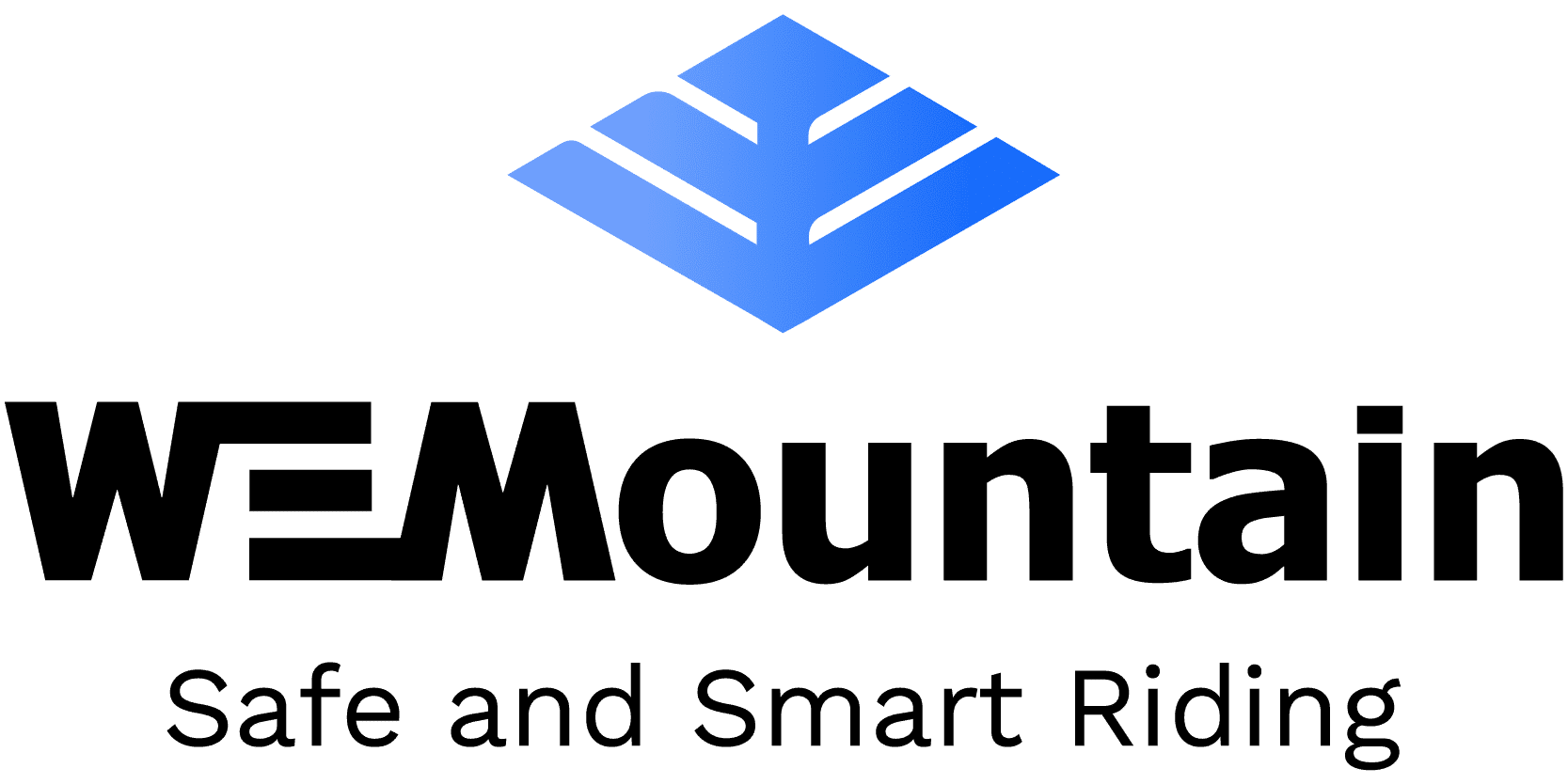Interview: Robert Bolognesi, Skieur libre et nivologue

Mathieu Ros Medina est passioné de montagne, ski et snowboard avec plus de 15 ans d'experieince en tant que journaliste dans ces domaines.
Docteur en géographie (Grenoble, 1991) et en informatique (EPFL, 1999), Robert Bolognesi est un authentique amoureux de la neige, qui parcourt les Alpes et les montagnes du monde en tant que spécialiste des avalanches. Il a participé à la création de stations de ski dans les années 80, établi des méthodes pour éditer des bulletins locaux d’avalanche, sécurisé des routes (via son bureau d’études Meteorisk) et défriché des pans entiers de la modélisation appliquée à la neige et aux avalanches. Éditeur et auteur de nombreux livres sur les avalanches, conférencier, programmeur, statisticien, pisteur-artificier, Robert Bolognesi est surtout un skieur complet, avec une vision bien personnelle de la liberté. On le rencontre en haut du col de la Forclaz, en plein été, sur une terrasse au bord d’une route de montagne dont il a assuré la sécurité pendant 15 ans (au niveau du Col des Montets).

Mathieu Ros (MR): Pour commencer, peux-tu nous raconter un peu comment tu en es arrivé là, Robert Bolognesi ?
Robert Bolognesi (RB): J’aime la neige ! J’ai d’abord été pisteur à l’Alpe d’Huez ; j’allais très souvent travailler en peaux avec mes Rossignol 3G de 2m05, mes Dynafit 3F et mes Securafix. Ce matériel était terriblement lourd mais je me disais « ce sera bien à la descente ». J’ai saisi très tôt l’intérêt de la modélisation pour mieux appréhender les avalanches. Je me suis donc mis à la programmation. Comme la montagne est un milieu naturel, il y a toujours cette croyance que tu peux « sentir les choses ». Mais en fait, c’est de la statistique « subjective » qu’on peut formaliser mathématiquement. Ensuite, j’ai toujours cherché à approfondir mes connaissances et à les confronter à mes observations de terrain.
MR: Ça veut dire que tu fais plus confiance à la machine qu’au guide de haute montagne ? tu ne crois pas à l’expérience en montagne ?
RB: Si bien sûr que je crois à l’expérience (et à l’intuition) du guide de haute montagne ! Mais l’objectif du guide est d’aller au but fixé et de ramener les gens sans incident et dans les meilleures conditions. Pour cela, il a le choix de l’itinéraire et, en cas de doute, il peut changer de course. Le prévisionniste n’a pas ce choix : il ne peut pas déplacer la route ou le village à sécuriser ! Il lui faut donc prévoir quand l’avalanche va se produire, quelle sera sa taille et jusqu’où elle va descendre. Et pour cela, l’ordinateur est sans conteste un assistant précieux.
En résumé : pour prévoir au mieux les avalanches, je pense qu’il faut de l’expérience ET des connaissances théoriques ET des données ET des outils logiciels performants.
MR: L’avalanche c’est une science exacte? Qui se reflète dans le bulletin d’avalanche ?
RB: On prévoit en tout cas un peu mieux les avalanches aujourd’hui qu’il y a 30 ans ! Et le bulletin est toujours de meilleure qualité. Celui-ci ne donne toutefois qu’une information générale, tout comme un panneau placé à l’entrée d’une forêt, qui indiquerait tantôt : « aujourd’hui, il y a des biches », tantôt « aujourd’hui les tigres sont de sortie ». On ne dit pas où ils sont, mais on dit qu’il y en a. C’est une information sommaire mais déjà précieuse pour le baroudeur novice.

MR: Tu as participé à la création de l’échelle européenne pour le risque d’avalanche, tu peux nous en dire plus ?
RB: J’ai participé à la création de l’échelle européenne des dangers d’avalanche en tant qu’auditeur chargé de faire des observations et des suggestions.
Au début des années 90, les gens étaient de plus en plus nombreux à skier hors-piste, et plus seulement dans leur région. Mais chaque pays avait sa propre échelle d’où une grande confusion. C’était l’époque de la création de l’UE, avec de nouvelles perspectives de collaborations scientifiques. Le contexte était donc très favorable à la standardisation de l’information sur le danger d’avalanche avec la création d’une échelle commune à tous les pays d’Europe.
Ce projet était enthousiasmant mais son déroulement, ponctué d’âpres négociations, fut parfois assez théâtral… Les Suisses n’avaient pas très envie d’adopter une échelle à 8 degrés, car c’était ce qu’avaient fait les Français auparavant. Et bien sûr, les Français ne voulaient l’échelle à 7 niveaux en vigueur en Suisse ! Et puis personne ne voulait d’une échelle à 9 niveaux parce que cela paraissait compliqué, ni d’une échelle à 6 niveaux sans « milieu ». Pour finir une échelle à 5 degrés a été choisie. Bon. Le problème, avec cette échelle simple, c’est que le degré 1 n’est pas très utile : il est surtout annoncé quand il n’y a pas de neige et qu’on ne skie pas (actuellement, il est toutefois mieux utilisé). Et puis le degré 5 tu n’en as pas besoin parce qu’à moins d’être complètement fou, tu comprends facilement que le risque est très fort. De toute façon les routes sont fermées et tu n’arrives même pas à glisser tellement il y a de neige. Donc il reste 2, 3 et 4. C’est trop peu. Alors ils se sont dit qu’on allait mettre des niveaux intermédiaires, ce qui est en place en Suisse depuis l’hiver dernier. Parce que modifier l’échelle au niveau européen, tu n’y arrives plus, il faut réunir tous les pays,
et que tout le monde soit d’accord… Pour ma part, je trouve que cette initiative est bonne car elle permet, sans tout changer, de rendre l’échelle plus précise. Le 2+ n’était peutêtre pas indispensable : c’est surtout le 3+ et le 4+ qui apportent une précision appréciable. Il y a 2+, 3-, 3=, 3+, etc. L’échelle est plus fine, mais sera-t-elle bien utilisée ? De nombreux professionnels te diront qu’on a amélioré la tronçonneuse, mais que le bucheron n’est pas meilleur pour autant. A la décharge des personnes qui rédigent les bulletins, on peut relever qu’il est difficile d’attribuer un niveau de risque. En effet, celui-ci dépend de l’instabilité du manteau neigeux mais aussi de la taille des avalanches. Donc pour un même degré 4, on peut avoir beaucoup d’avalanches de taille moyenne ou quelques avalanches de très grande taille. La lecture complète du bulletin est donc indispensable pour bien comprendre la situation.

MR: La cartographie avec les applis sur smartphone pourrait selon toi être une solution?
RB: A l’avenir peut-être, mais pas aujourd’hui. En effet, le skieur a besoin de connaître le danger là, sur la pente qu’il va descendre. Or, on ne peut pas déterminer ce danger à partir du bulletin, même en connaissant la déclivité et l’orientation de la pente. En effet, l’instabilité dépend d’un très grand nombre de facteurs locaux qui ne sont pas mesurés actuellement et difficilement calculables. De plus, certaines avalanches sont héritées d’épisodes météorologiques anciens et sont donc très difficiles à prévoir sans un examen local du manteau neigeux. Par exemple : après 3 semaines de temps bien sec et bien froid en début de saison, lorsque le manteau neigeux est encore peu épais, une couche de neige fragile se forme dans les faces Nord ; puis, en fin de saison, de grandes avalanches surviennent à la surprise générale, comme pour l’Xtrème de Verbier cet année : au Bec des Rosses, le manteau est parti jusqu’au sol alors que l’enneigement était plutôt modéré.
Mais dans les modèles, tu es obligé de simplifier les phénomènes et de limiter le nombre des données, sinon chaque situation devient un cas unique et l’apprentissage devient donc impossible. Plus les descriptions sont détaillées, moins le modèle sera efficace sauf à disposer d’une énorme base de données. Aujourd’hui, on a vraiment bien développé les méthodes d’apprentissage, mais le phénomène de l’avalanche est tellement multifactoriel qu’il est encore très difficile de les appliquer. Une bonne prévision locale sur smartphone n’est pas encore d’actualité.
MR: Donc ce que tu dis c’est que la modélisation c’est super mais elle dépend de trop de paramètres pour que ce soit utile à un skieur de rando ?
RB: Exactement. Mais demain, la modélisation sera peut-être une éminente alliée du skieur car les progrès de l’IA sont incroyables en ce moment !En attendant, le skieur peut poser lui-même un diagnostic. Il lui faut connaître les critères les plus pertinents décrivant les conditions nivo-météorologiques, topographiques, géographiques, et le groupe. Ces critères peuvent permettre d’établir un score chiffré aidant à mieux apprécier un risque local. Si ces facteurs sont bien choisis et s’ils déterminent la probabilité d’avalanche mais aussi le dommage potentiel, alors le diagnostic sera fondé et la décision sera raisonnée.

MR: Tu t’es déjà trouvé dans des conditions avalancheuses en montagne? on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais si je soirs avec toi en montagne je suis censé être plus en sécurité…
RB: Oui, cela m’est arrivé (rarement) et je n’en suis pas fier. Fermer une route très fréquentée peut paralyser une région entière. Il faut être sûr de prendre la bonne décision et c’est seulement en allant relever des données dans les zones de départ que tu peux le faire. Dans ce cas je me faisais déposer en hélico entre les 2 aiguilles là, je cherchais un parcours sûr dans les rochers, je posais une corde pour descendre dans la pente, sans trop m’avancer. Je faisais mes profils et tous les relevés utiles. Puis si je jugeais que le manteau était finalement assez stable, je m’engageais dans la descente. Sinon je me faisais reprendre par l’hélicoptère, parce que non seulement je pouvais me faire emporter, mais je risquais encore de déclencher une avalanche sur la route. Je n’ai pas répété ces opérations très souvent car ce genre de travail est vraiment très exposé.
MR:Les italiens sont hyper agressifs, avec des procès récents contre les skieurs qui déclenchent des avalanches, qu’est-ce que tu en pense ?
RB:Je pense qu’il y a des zones qui devraient être interdites temporairement aux skieurs. Par exemple : les zones qui dominent des files d’attentes des remontées mécaniques. Parce que si une avalanche se déclenche là, le gars tue peut-être 15-20 personnes. Je sais que dans le monde de la montagne on ne veut rien entendre sur de telles restrictions mais, à mon avis, il faut interdire quelques zones sensibles pour pouvoir laisser les autres libres sinon, un jour ou l’autre, il y aura un gros accident et ensuite de multiples interdictions.
En revanche, je ne considère pas que déclencher une avalanche soit un délit, pour autant que les skieurs se soient assurés, avant de s’engager dans la pente, qu’une avalanche qu’ils déclencheraient ne causerait aucun dommage. Quoiqu’il en soit, les tribunaux appliquent le droit et chacun doit s’y conformer…
MR: On peut faire le parallèle avec la plongée, ou il faut un diplôme pour aller plonger…
RB:Certes, le résultat est positif, parce qu’il y a moins d’accidents. Mais tant que tu ne portes pas préjudice à autrui, ça ne me gêne pas que tu prennes des risques. Pour toutes les activités de plein-air, je recommanderais de bien se former, de bien s’équiper, de toujours s’informer et d’actualiser ses connaissances et son matériel, mais je ne suis pas favorable aux obligations et interdictions trop strictes et sans nuances.

MR: C’est quelque chose qui existe dans certaines stations, par exemple au Japon, avec un permis de sortir hors-piste après une formation DVA…
RB: Je trouve ça absolument détestable. Si tu es pris dans une avalanche, une fois sur deux tu es mort avec ton DVA. C’est comme une bouée sur un transatlantique. Pour moi il tout faire pour ne pas déclencher d’avalanche et surtout, il est fondamental de ne pas porter préjudice à quelqu’un d’autre. On a un devoir de prudence (et pas seulement d’assistance) les uns envers les autres, mais chacun devrait rester libre de choisir comment se protéger.
MR: Après tout ce matériel de sécurité et ces formations ont bien fait évoluer et progresser la pratique…
RB: C’est très positif, et c’est pour ça que quand Dominique Perret m’a demandé un coup de main sur WEMountain j’ai tout de suite dit oui. C’est bien que les gens se forment, et qu’ils se forment au mieux. C’est bien qu’on puisse les informer, donc le bulletin d’avalanche, même si il n’est pas parfait, est très utile. C’est juste quand on commence à asséner les mots « obligatoire » et « interdit » que j’ai du mal à approuver.